Loïc Hecht : “Si les gens veulent du changement dans le traitement de l’information, ça viendra d’un changement dans leur manière de la consommer”

Loïc Hecht auteur du “Syndrome de Palo Alto” – Crédit : Presse
Journaliste indépendant depuis plusieurs années maintenant, Loïc Hecht fait parler de lui depuis quelques mois pour une nouvelle forme d’écriture qu’il a abordé, celle d’un roman. “Le Syndrome de Palo Alto” (éd. Leo Scheer) vient de sortir et doit absolument être lu. Outre le fait que l’intrigue se déroule parfaitement, c’est surtout l’analyse profonde et incisive de notre société qui est marquante. Loïc a passé des années à glaner la moindre information sur la Silicon Valley, son milieu de techies et autres geeks et nous les consommateurs. Qu’on se le dise, son travail remarquable a de quoi nous remettre les idées en place. Alors qu’il pointe du doigt le numérique et ses dérives, il était nécessaire d’échanger avec lui sur ce sujet à une période où la distance imposée par le confinement n’a jamais autant servi les réseaux et desservi notre cerveau.
« Le Syndrome de Palo Alto » est ton premier roman. Un livre édifiant sur notre société à l’ère des internets et des réseaux sociaux. Pourquoi ce sujet ?
Je fais partie d’une génération de journalistes qui a débarqué sur le « marché » à une époque où les blogs vivaient un crépuscule flamboyant, où Twitter émergeait, et où le webjournalisme venait bousculer le train-train ronflant des rédactions print. Un peu comme une constante, j’ai toujours exploré les marges du numérique, en questionnant la place que ça prenait dans nos vies et en cherchant à comprendre l’impact que ça pouvait avoir sur notre psyché et nos relations. Ça a commencé en conduisant des expériences littéraires chelous sur Chatroulette ou Omegle sur le blog que je tenais à l’époque, et puis, que ce soit en tant que journaliste indépendant ou lorsqu’on a monté Snatch Magazine, c’est devenu un fil rouge. J’ai travaillé sur des mecs qui faisaient du racket dans Second Life, j’ai enquêté sur les dessous de Jacquie et Michel, j’ai passé du temps avec les figures notoires transhumanistes de la Silicon Valley… Du coup, ancrer mon premier roman dans un univers où il est beaucoup question d’Internet, de réseaux sociaux, avec des personnages en tension permanente par rapport à la place que ça prend dans nos vies, c’était la continuité. Mais je n’avais pas envie de faire une auto-fiction où j’aurais parlé de ma dépendance à Instagram et de mes dates Tinder sur fond de considérations personnelles un peu bas du front. J’ai cherché pendant longtemps le moyen de dépasser cet écueil. Finalement, j’ai ancré l’histoire à San Francisco, un lieu dont le tissu social est directement impacté par le temps que nous passons sur nos téléphones ici. C’est un peu l’effet papillon. Plus on utilise ces applications et ces services ici, plus les GAFAM (acronyme des géants du web : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et autres tech companies deviennent puissantes, plus elles ont besoin de recruter, et plus les gens qui vivent là-bas et ne travaillent pas dans cette industrie sont impactés négativement, marginalisés, et finissent par en avoir ras-le-bol. C’était ça mon point de départ : le « numérique » n’est pas synonyme de « virtuel ». Il a des implications économiques et sociales, et sa manière de reproduire des schémas d’oppression conduit à générer des radicalisations et des conflits physiques.
Il y a donc, derrière ce livre, une volonté d’alerter ? De remuer un peu les idées ?
L’histoire derrière « Le Syndrome de Palo Alto », c’est une fresque, celle d’une génération biberonnée à l’Internet et au culte du soi : la nôtre. C’est un roman chorale, avec un startupper viré de sa boite qui peine à rebondir, une étudiante à Berkeley qui gagne sa vie en faisant des cam shows coquins sur internet, un webjournaliste cynique et carriériste qui couvre l’actualité de la Silicon Valley, et un groupe d’activistes anti-tech énervés, qui ne peut plus blairer l’emprise de cette industrie sur cette ville. En guise de fil rouge, on suit la radicalisation de ce startupper qui renie tout ce qui l’a animé jusque-là. Ces personnages et ce cadre m’ont servi à écrire un livre qui interroge notre rapport ambigu aux outils technologiques modernes et raconte comment chacun d’entre nous compose entre condition d’otage consentant des géants du Web, vaine gloire, et désir d’un monde meilleur. C’est ce triangle sentimental trouble qui est au cœur de nos vies surconnectées qui donne son titre à l’ouvrage. C’était vraiment important pour moi de questionner ce rapport pas clair que nous avons avec ces appendices technologiques qui ont envahi nos existences et colonisé nos rapports sociaux. J’ai voulu aussi écrire un roman qui lève un coin de voile sur cet envers du décor de la Silicon Valley, et par extension, sur ses dérives. Les GAFAM incarnent désormais un véritable pouvoir en soi. Sans tout rejeter en bloc, c’est vraiment important d’être technocritique, tant les abus se multiplient. L’affaire Cambridge Analytica a par exemple fait éclater au grand jour que Facebook avait engendré un système et une masse de données personnelles suffisamment critique et redoutable pour que ce soit retourné contre nous, que cela serve à nous manipuler psychologiquement, au point d’influer sur des processus démocratiques, comme cela a été le cas aux États-Unis avec l’élection de Trump, ou au Royaume-Uni avec le Brexit. Or, à aucun moment, les fondateurs de la plateforme ne semblent avoir entrevu les failles, ni imaginé qu’un tel scénario puisse se produire. De la même façon, on sait qu’Amazon, Microsoft ou Google, les entreprises à la pointe du cloud computing et du machine learning, lorgnent sur de mirifiques contrats sécuritaires gouvernementaux pour mettre leurs technologies au service d’un appareil de surveillance des citoyens basé sur la reconnaissance faciale et autres joyeusetés du genre. Et on pourrait dérouler une liste infinie. C’est donc aussi un roman qui porte des idées, qui glisse subrepticement des éléments d’enquête, qui puise dans la littérature et la philosophie critique de la technique.
Le « numérique » n’est pas synonyme de « virtuel ». Il a des implications économiques et sociales.
Les moindres détails sont la clé d’un bon roman mais il faut admettre qu’à la lecture du livre, la frontière est tellement fine avec la réalité que c’est très perturbant, presque inconfortable. Combien de temps as-tu mis pour réunir toutes tes informations ? Comment se passe le processus de création dans ces cas là ?
J’ai travaillé quatre ans sur ce roman, dont deux et demi à temps quasi plein. En amont et en aval de l’écriture du livre, j’ai fait deux séjours de plusieurs semaines dans la baie de San Francisco pour peindre la Silicon Valley de la manière la plus réaliste qui soit. De façon à ce que mes personnages – qu’ils soient start-uppers ou activistes – soient crédibles, il a fallu d’une part conduire des interviews, mais clairement, ce qui m’a pris le plus de temps, plus encore que l’acte d’écrire en soi, ça a vraiment été l’étude des textes qui ont nourri le mien. Et entre les essais sur comment « disrupter » un secteur économique et triompher avec sa start-up, et la critique philosophique de la technique, c’est un peu le grand-écart. Les périodes d’écriture ont souvent été entrecoupées de longs mois à ingérer de la matière et la digérer. Et puis, il y avait une veille quotidienne sur les évolutions dans l’univers de la tech et de la Silicon Valley. Armé de tout ça, j’ai composé un monde qui mordait beaucoup sur le nôtre, avec plein de références et même certains protagonistes directement tirés du réel. D’autres en sont des émanations extrapolées. Cela instille un doute permanent. Et puis, surtout, pendant ces deux ans et demi à temps quasi plein, je suis parti de Paris. J’ai vécu dans pas mal d’endroits, souvent des résidences d’artistes, loin des villes. Le livre se passe à San Francisco, mais paradoxalement, je l’ai écrit entre le nord de la France, l’Estonie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne.
« Faut arrêter de se voiler la face, les gars ! Les maîtres du capitalisme, c’est les fabricants d’ordinateurs et de téléphone, les bidouiller d’algorithmes, les manitous de l’intelligence artificielles, les fournisseurs d’accès à internet… Les banquiers et les industriels sont à la solde de ces mecs-là. Le rapport de force s’est inversé ! C’est eux l’ennemi ! » Cet extrait p.173 de ton livre sonne d’une façon très particulière dans la période que nous vivons où tout semble s’être arrêté et en même temps nous n’avons jamais été aussi connectés. Les données internet ont explosé à cause du confinement. Comment perçois-tu tout cela ?
En vertu de ce que j’évoquais un peu plus tôt sur le pouvoir des GAFAM et leur agenda économique et politique, il me semble qu’il convient donc d’être plus vigilant que jamais, d’autant que ces entreprises apparaissent d’ores et déjà comme les grandes gagnantes de l’épisode actuel de confinement relative au COVID-19. Non pas que ce soit une totale surprise, mais en un mois, elles ont démontré qu’elles étaient incontournables sur le travail à distance, la communication avec nos proches, le divertissement, les achats en ligne et la livraison. Autrement dit, elles ont encore resserré leur emprise sur nos vies, en se rendant indispensables dans tous les compartiments. Je note aussi que dans ce moment qui entérine l’échec de nos États modernes à garantir la santé et donc la sécurité physique des citoyens, la faute à la tentation ultra-ultralibérale à laquelle ils ont cédé, ce sont là encore les entreprises de la Silicon Valley qui en tirent profit en investissant tous les espaces laissés béants. Aux États-Unis, Verily une des entreprise d’Alphabet, la maison-mère de Google, a rapidement mis en place un site pour permettre à quiconque de déterminer s’il était éligible à un test, et où aller le plus près de chez lui le cas échéant. En Angleterre, lorsque le gouvernement a émis la possibilité de mettre en place un test individuel à grande échelle, Amazon s’est tout de suite porté volontaire pour en assurer la logistique. De la même façon, des systèmes de santé en Angleterre, Autriche, Espagne et Allemagne travaillent déjà dans la main avec Palantir, le géant de la Silicon Valley spécialisé dans la surveillance, pour maximiser le fonctionnement des hôpitaux. Ces algorithmes servent à anticiper les pénuries de staff, de respirateurs, de médicaments, etc. et à les répartir en temps réel où l’on en a besoin. En France, l’AP-HP et ses 39 hôpitaux sont actuellement en négociation pour se doter de la solution vendue par Palantir. À un premier niveau de lecture, c’est tout à fait louable, si ça peut sauver des vies, c’est quand même super, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais pour autant, ça n’empêche pas de se poser des questions. Est-ce que les données utilisées, notamment celles des patients, seront vraiment départies des détails les plus personnels comme l’entreprise le promet ? Si après l’épisode de COVID-19, l’AP-HP ou une agence de santé veut récupérer ses données et construire son propre système, est-ce qu’on lui rendra dans un état exploitable ou faudra-t-il repartir de zéro ? Bref, en ayant eu zéro politique concrète en la matière, et en ayant laissé les GAFAM s’octroyer le champ de l’exploitation de nos données personnelles, on se retrouve à leur merci pour nous sauver la mise, en leur filant encore plus de données. Forcément, ça interroge.
Florence, c’est une patronne, elle donne une leçon quasiment à chaque fois qu’elle se colle derrière son clavier. A une époque où le journalisme est beaucoup bashé – et à raison –, ça fait du bien de lire des artistes du genre, qui se permettent de faire fi de toutes les contraintes pour rendre un peu de noblesse au truc.
Dans ton roman, personne n’est épargné. Pas même les journalistes – incarnés par ton personnage au nez fin Anthon Faithful – qui sont contraints de faire du clic à tout prix. Quel est ton avis sur le métier aujourd’hui ? La manière dont l’information est traitée en ce moment t’inspire quoi ?
Comme beaucoup de gens, je suis partagé sur la question. Je porte le journalisme haut dans mon cœur. C’est une discipline qui peut être exercée comme un art à part entière. Je tombe régulièrement sur des reportages ou des enquêtes qui me laissent admiratif par leur qualité, sur tout un tas de sujets. Récemment, comme tous ceux qui l’ont lu, j’ai été happé par l’immersion de Florence Aubenas dans un Ehpad de Bagnolet lors des douze premiers jours du confinement. Bon, Florence, c’est une patronne, elle donne une leçon quasiment à chaque fois qu’elle se colle derrière son clavier, mais bref, à une époque où le journalisme est beaucoup bashé – et à raison –, ça fait du bien de lire des artistes du genre, qui se permettent de faire fi de toutes les contraintes pour rendre un peu de noblesse au truc. J’ai plusieurs abonnements à des médias français et anglo-saxons, et même si je suis bien content qu’il existe encore des bastions d’informations de qualité qui sont gratuits, l’idée qu’une bonne information coûte de l’argent à produire me paraît évidemment censée. À l’époque où nous faisions Snatch Magazine, notre principe de base était toujours de raconter des histoires qu’on n’avait lues nulle part ailleurs, ce qui requérait d’aller chercher la matière première à la source. Nos moyens financiers étaient limités, ce qui impliquait donc souvent de voyager à moindre frais et de dormir dans des hôtels pas dingos, mais honnêtement, ça nous allait très bien. On bougeait aux quatre coins du monde parce que c’était non-négociable pour produire un canard à la hauteur de ce qu’on voulait. Et si le magazine avait été gratuit, je ne crois qu’on y serait arrivé. Après, je ne veux pas non plus trop romanticiser l’affaire sur les histoires de fric. Lorsqu’on a arrêté, l’essentiel de nos revenus provenaient de ce qu’on appelle des « opérations spéciales » dans le jargon – production de magazines, de sites, de vidéos, etc. – pour des marques qui venaient précisément parce qu’elles avaient été attirées en premier lieu par la qualité des plumes, des photographes, du graphisme. C’était un cercle vertueux dans ce sens. Et c’est d’ailleurs sur une économie similaire, mais à un degré économique supérieur, avec carrément une boîte de prod et des ressources humaines impressionnantes, que fonctionne un groupe indépendant comme SoPress dont la qualité des titres est globalement remarquable, et dont l’un des grands mérites est de ne pas céder dans son traitement à la tentation et à la folie des hard news. Maintenant, pour en revenir là où le bât blesse, une Florence Aubenas, ce n’est pas la norme. Déjà, économiquement, y a pas grand-monde à part Le Monde qui a les moyens de détacher une journaliste à plein temps pendant trois semaines ou un mois sur un sujet. Et puis, surtout, le consommateur moyen d’information, ce n’est pas un mec qui est abonné à deux magazines et trois quotidiens en ligne, et qui se fade des articles qui prennent trente minutes à lire. Avec le modèle du journalisme en ligne basé sur les revenus publicitaires, le lecteur a pris l’habitude d’avoir tout gratuitement, et ce n’est donc pas évident d’en revenir à un point où il faut payer. Par ailleurs, dans un monde où notre attention est sans cesse piratée par les notifications, il nous est difficile de nous concentrer plus de quelques minutes. Enfin, aujourd’hui, l’information est un marché comme un autre. Les producteurs de contenus sont des acteurs économiques. Ils se battent pour une manne financière qui est proportionnelle à l’audience qu’ils enregistrent, et cette audience, elle se capte grâce aux articles qui remontent dans Google et sur les réseaux sociaux. Autrement dit, ça demande de dégainer très vite pour sortir de la nasse, avoir de la visibilité, et capter les revenus publicitaires pour le média, et la rémunération en égo pour le journaliste. Le problème, c’est qu’en la matière, vitesse et journalisme de qualité sont antinomiques. Et sans même sortir la carte des fake news – qui est encore un autre sujet –, voilà comment on se retrouve avec des sujets complexes traités n’importe comment, à la va-vite. Et comme les journalistes ont la mauvaise habitude de souvent s’inspirer de ce que font les petits camarades avant de traiter le sujet à leur tour, la pelote peut vite prendre des proportions terrifiantes.
J’ai le sentiment qu’on est tous responsables de ce fiasco, journalistes et lecteurs.
Du coup on tape sur les journalistes mais les faits sont là : il y a aussi le public pour encourager ce traitement de l’information. C’est le chien que se mort la queue…
J’ai le sentiment qu’on est tous responsables de ce fiasco, journalistes et lecteurs. Lorsque l’actu s’emballe, on a vite fait de se transformer en chacal à la recherche du moindre bout d’os qui n’a pas encore été rongé. Et ça vaut dans les deux positions. L’affaire Griveaux ou plus récemment, et dans une mesure un peu différente, l’emballement autour de Didier Raoult et de l’hydroxychloroquine, en sont deux exemples typiques. Les journalistes, bien sûr, en réaction à ce mécanisme économico-égotique que j’explicitais font tout pour dégainer le plus vite possible, quitte à avancer des informations non vérifiées ou mal dégrossies. Mais ils répondent aussi à une demande de lecteurs qui en veulent toujours plus. Mais en même temps, un bon gestionnaire doit aussi savoir tenir son public en haleine et feuilletonner ses révélations. Dans mon roman, c’est exactement ce que fait le personnage d’Anton Faithful. Assez tôt, on apprend que ce journaliste cynique qui enquête sur la disparition d’une star des réseaux, a poussé le vice jusqu’à négocier une prime avec son employeur. Ainsi, à chaque fois qu’un de ses articles dépasse x vues, il a une prime de deux cents dollars. Il a donc tout intérêt à dégainer vite, à frapper fort pour avoir de la visibilité et viralité, mais en même temps à être assez malin dans la distillation des informations qu’il possède pour multiplier les primes. Ça grossit un peu le trait, mais vu le contexte, ce ne serait pas du tout délirant d’en arriver là. En fait il y a un gros pan du journalisme qui s’assimile à l’industrie de la malbouffe. On sait que ça ne fait pas du bien sur le long terme, mais c’est un plaisir coupable, et tant qu’il y aura de la demande, il y aura de l’offre. C’est un peu le principe du succès de BFMTV ou des émissions de Pacal Praud sur CNEWS. Tout le monde s’en afflige, mais n’empêche que si les gens en parlent, même si c’est pour s’en offusquer, c’est parce qu’ils les ont vues en premier lieu. Donc ça s’auto-alimente. Bref, si les gens veulent du changement dans le traitement de l’information, ça viendra sans doute d’abord d’un changement dans leur manière de la consommer.
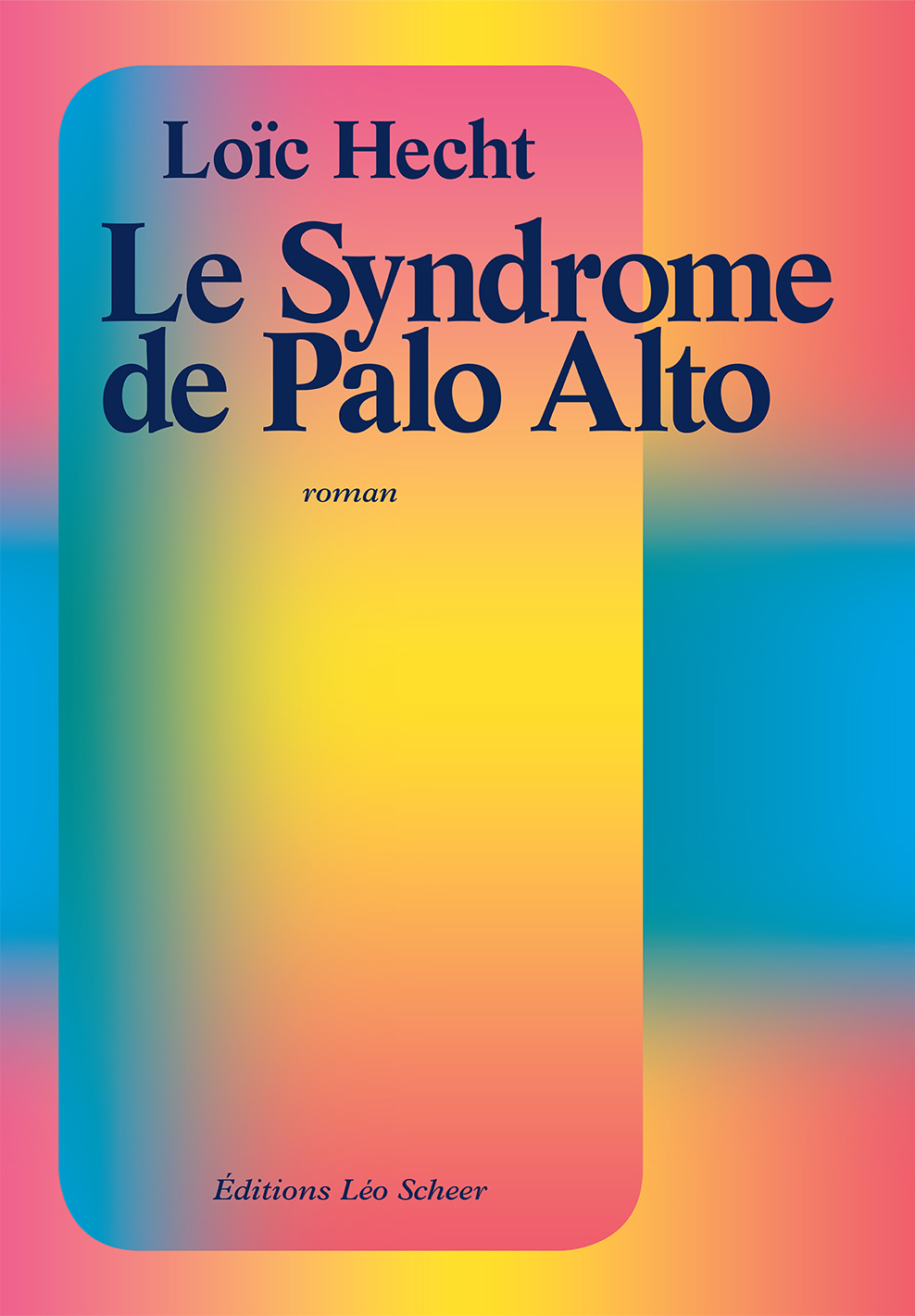
Couverture du livre “Le Syndrome de Palo Alto” – Crédit : Presse
Sur le même thème
Margaux Benn : une journaliste en territoire taliban
La journaliste Margaux Benn - Crédit : PresseÀ 33 ans, la journaliste Margaux Benn couvre l’actualité de l'Afghanistan depuis plusieurs années pour différents médias : France 24, Arte, Le Figaro, Europe 1… Alors que les talibans sont revenus à la tête du pays, la...
Le questionnaire de… Ornella Fleury
Ornella Fleury « T’as vu ? Ils ont dit qu’ils allaient faire payer les notes vocales. C’est un vrai truc hein, je l’ai vu sur Internet ! » dixit Camille, la trentenaire parisienne célibataire accro à son téléphone et sa copine (imaginaire ?!) au bout du fil,...
Antoine Bonnet, du podcast Fluctuat Nec Mergitur : « J’ai posé le micro et je lui ai dit “Roman, raconte-moi” ».
Cover du podcast Fluctuat nec mergitur à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute - Crédit : PresseRoman était à La Belle Equipe le 13 novembre 2015 avec son groupe d’amis pour l’anniversaire de sa compagne Jessica. Il raconte au micro de son ami Antoine le récit...

0 commentaires